
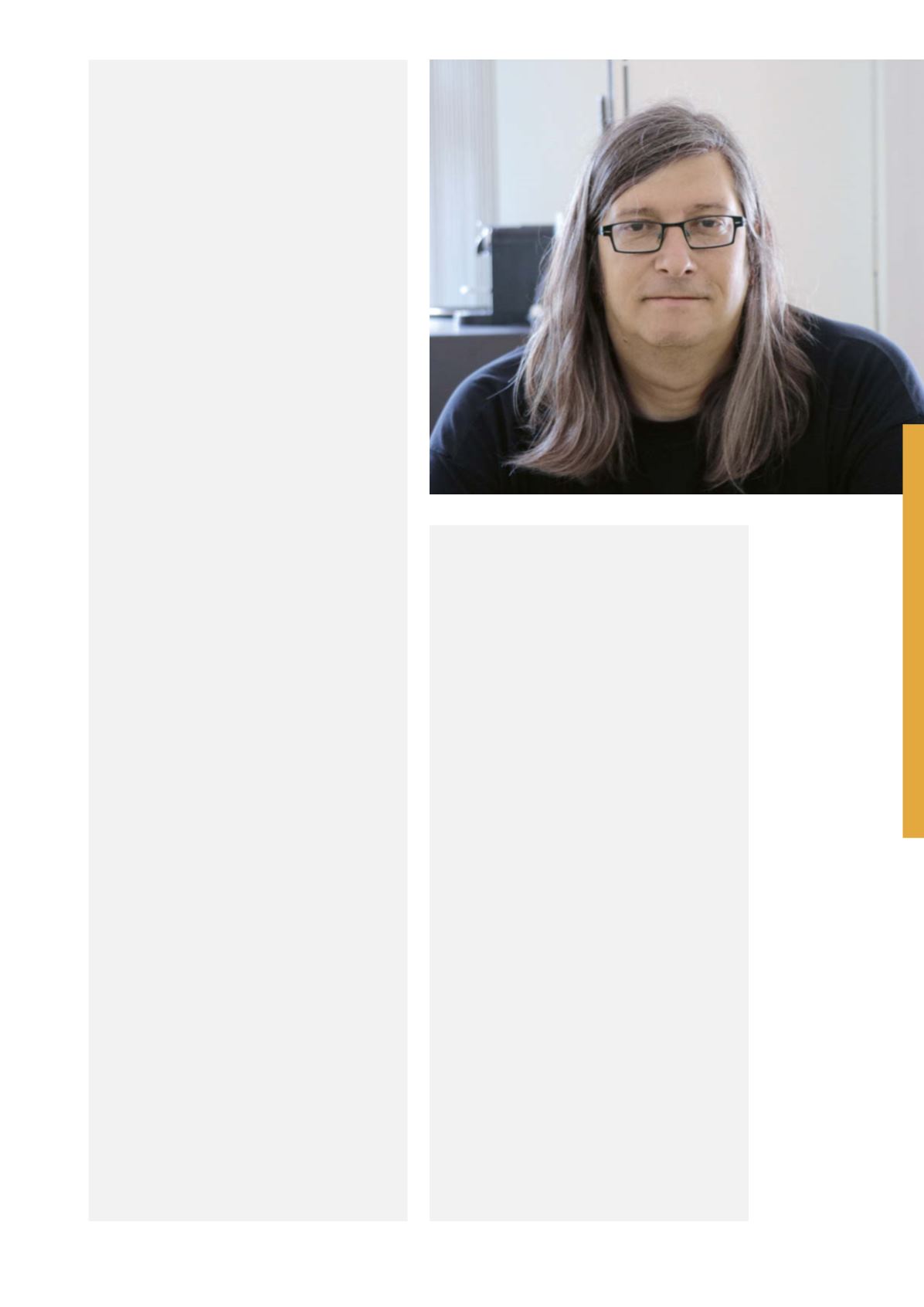
13
ENSEMBLE 2017/20 —– Dossier
Comment ces prestations sont-elles financées?
Les membres de l’Eglise assujettis à l’impôt
ecclésiastique, autrement dit les personnes phy-
siques, représentent la principale source de finan-
cement. A cela s’ajoute l’impôt ecclésiastique des
personnes morales. Enfin il y a le paiement des
salaires du corps pastoral par l’Etat: le système va
être adapté, mais l’enveloppe financière globale
ne changera pratiquement pas par rapport à la
situation actuelle.
L’Etat continuera de cofinancer les prestations four-
nies par les Eglises. Quels avantages en retire-t-il?
C’est une bonne question, car il faut se deman-
der où se situent d’une manière générale les
intérêts de l’Etat. Cette question doit être tranchée
au niveau politique. En raison de la législation
actuelle, l’Etat a tout intérêt mais aussi le devoir
de soutenir les Eglises en tant qu’institutions, et
il doit également indemniser certaines activités
d’utilité publique accomplies par ces dernières.
Une pression financière croissante s’exerce sur la
politique sociale. Il y a là une niche où les Eglises
peuvent offrir des prestations. On leur laisse
accomplir ce travail tout en garantissant ainsi leur
pérennité. Car les Eglises fournissent des services
que l’Etat ne pourrait pas proposer sous cette
forme.
Quelle est l’importance sociopolitique de ces pres-
tations?
S’agissant de l’Eglise, il est important que les
prestations fournies recueillent l’adhésion d’un
large pan de la société, et pas seulement de la par-
tie de la population convaincue par son action.
Pour la société, il est important qu’un acteur fort
et indépendant propose des services aux plus
faibles et aux personnes défavorisées. Car parmi
elles se trouvent certainement des gens qui
hésitent à se tourner vers l’Etat. L’autre aspect so-
ciopolitique important est que les Eglises peuvent
ainsi faire entendre leur voix auprès du public.
Que se passerait-il si les prestations de l’Eglise
disparaissaient?
L’Etat ne pourrait pas intervenir dans tous les
cas. Professionnaliser le travail accompli au-
jourd’hui à titre bénévole serait financièrement
presque impossible. Au niveau politique, l’Etat
vérifie minutieusement ce qui est véritablement
nécessaire et ce qui ne l’est pas. Les Eglises ont ici
une certaine marge de manœuvre. Par exemple, le
canton pourrait difficilement proposer des
après-midi des aînés. Quelques communes le
feraient peut-être, mais d’autres pas. Sans les
Eglises, certaines prestations sociales seraient tout
simplement abandonnées. Cela créerait des
lacunes. Il est difficile d’évaluer quelles en seraient
les conséquences pour les groupes de personnes
qui bénéficient aujourd’hui de ces prestations.
Peut-on imaginer que d’autres acteurs prennent le
relais, comme des organisations non gouvernemen-
tales?
Dans une certaine mesure, c’est sans doute ce
qui se passerait, mais cela varierait d’un thème à
l’autre. Les grandes œuvres d’entraide de l’Eglise
comme l’EPER ou Caritas seraient certainement
assez solides pour survivre. Dans des domaines
comme celui de la migration notamment, il est
probable que d’autres organisations intervien-
draient aussi pour combler les lacunes.
Selon vous, comment le financement des Eglises
va-t-il évoluer à l’avenir?
L’évolution de l’effectif des personnes physiques
jouera un rôle déterminant. Si le nombre de
membres reste au niveau actuel, les Eglises se trou-
veront dans un contexte relativement favorable.
En revanche, si les départs de l’Eglise se multi-
plient, le volume de l’impôt diminuera et la légi-
timation sociale des prestations soutenues par
l’Etat sera affaiblie. L’effectif des membres est aussi
le domaine où les Eglises ont le plus de possibilités
d’agir. Elles peuvent convaincre les gens de l’im-
portance de leur action. Les dernières votations
sur la suppression de l’impôt ecclésiastique des
personnes morales organisées dans d’autres can-
tons montrent que pour l’instant, cette option n’est
pas à l’ordre du jour. Le canton de Zurich l’a clai-
rement rejetée il y a deux ans. Et dans un canton
très rural comme celui de Berne, le résultat serait
probablement encore plus clair.
Michael Marti
©Adrian Hauser
















